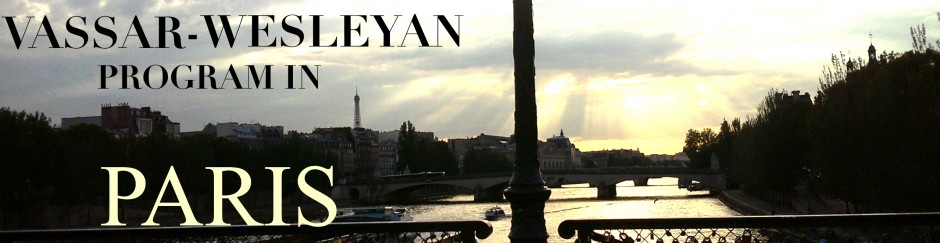Cours d’écriture intensive (writing intensive courses)
- Réagir sur la France d’aujourd’hui
- Littérature et journalisme- Les écrivains journalistes en France (du XVIIIe à nos jours)
- La Révolution française (1789-1799) : récits et imageries
- Paris médiéval
Séminaires (seminars)
- Installations : Lieux et Espace dans l’Art Contemporain
- L’art et la nature en France au XIXe siècle, du Romantisme à l’Art nouveau
- Panorama du théâtre contemporain
- Femmes, Féminisme, Genre en France (XIXe- XXIe siècles)
___________________________________________________________
Writing Intensive Courses (4)
1) Réagir sur la France d’aujourd’hui
Professeur Collet-Basset Le lundi de 12h à 14h
L’objectif de ce cours est d’aider les étudiants à améliorer leur expression écrite tout en développant leurs compétences dans les autres domaines de la langue française, l’expression orale ainsi que la compréhension écrite et orale. Chaque étudiant sera amené à progresser à son niveau et à utiliser son expérience en France comme source de réflexion sur la culture et la langue à travers des activités en classe et hors de la classe (participer à une sortie liée au cours et y réagir par écrit, mener un entretien avec un/une francophone et en rapporter le contenu, tenir un carnet de bord, exprimer son opinion sur des faits d’actualité…).
A travers les activités effectuées, les étudiants enrichiront leur vocabulaire dans les différents niveaux de langue et des domaines variés, et affineront leur style.
Les supports utilisés seront, entre autres, des films et documentaires, des passages d’émissions (télévision ou radio) ainsi que des extraits de presse et de littérature.
Tout au long du semestre, les étudiants suivront l’actualité, observeront et analyseront les habitudes, coutumes, objets, etc. qui les entourent dans leur vie quotidienne en France afin d’utiliser ces réflexions dans les différentes activités écrites et de contribuer aux échanges en classe. Ils seront ainsi amenés à mettre en perspective leur représentation de la société française et comprendre les enjeux au coeur des débats actuels.
.
2) Littérature et journalisme- Les écrivains journalistes en France (du XVIIIe siècle à nos jours)
Professeur De Chalonge Le mercredi de 14h30 à 16h30
Stendhal voyait dans le journalisme un « fossoyeur de la littérature » ! Et pourtant, avant le XXe siècle, et particulièrement au XIXe qui est le grand siècle de l’avènement de la Presse, le journalisme est essentiellement le fait des écrivains. C’est donc à travers les pratiques d’un écrivain qui se fait journaliste que nous nous proposons de lire les formes et les occasions données à ces « pages fugitives » comme les appelait Cendrars. Art de l’instantané et du transitoire, livrée parfois sous la « tyrannie de la circonstance » (Baudelaire), l’écriture journalistique a également su influencer durablement les formes littéraires elles-mêmes. C’est à travers de grandes plumes littéraires (Marivaux, Diderot, Rousseau, Voltaire, Balzac, Baudelaire, Hugo, Gautier, Zola, Mallarmé, Proust, Colette, Aragon, Malraux, Cendrars, Giono, Calet, Vian, Camus, Duras, Littell…) que nous nous intéresserons au reportage et à l’enquête, à la chronique, au pamphlet et à la satire, à la lettre ouverte et au « salon » de la critique d’art, ou encore à la pratique de l’interview… à travers tous ces genres, l’écrivain journaliste compose le récit de ses longs voyages, dénoue le glaçant fait-divers ou entreprend l’étude de mœurs. Il se fait aussi critique, pour l’art ou la littérature, devient écrivain-reporter sur les champs de bataille ou dans d’inconnus lointains, à moins qu’il ne cherche à intervenir politiquement. Le curieux et le sensationnel, le pathétique et le documenté, l’indignation ou la mauvaise foi seront autant de tonalités propres à illustrer dans sa variété cette littérature du quotidien.
Regroupées à l’intérieur de cinq séquences (• Etude de mœurs et fait divers ; • Reportage ; • Critique esthétique ; • Chronique ; • Prise de position politique), les textes étudiés seront fournis aux étudiants séance après séance en faisant varier les thèmes et les auteurs pour offrir la plus grande diversité.
.
3) La Révolution française (1789-1799): récits et imageries
Professeur Graille Le jeudi de 16h30 à 18h30
Par-delà les querelles de « chapelles », tous les historiens actuels s’accordent sur l’idée que la Révolution française fut un événement fondamental et fondateur, qui bouleversa profondément les institutions politiques et économiques, sociales et culturelles du royaume au XVIIIe siècle. Sans parler des répercussions européennes, puis mondiales, dont les ondes de choc perdurent jusqu’à nos jours. De nombreux témoignages de ces vastes crises, souvent vécues au quotidien par les populations, portent l’empreinte d’un trouble d’identité, d’une peine à se situer entre les ruines du monde ancien et les chantiers du monde nouveau, entre des crépuscules et des aubes. « Tout est à faire, tout est possible, ce qui était rocher il y a six mois est devenu cire. On peut donner au royaume la forme qu’on veut », écrira Dumont à Romilly le 9 août 1789. Dix ans plus tard, que sera devenu ce bel optimisme ?
À travers une série de documents hétérogènes et de visites guidées, nous valoriserons la complexité d’événements, de personnages, de thèmes et d’idées ayant marqué la décennie 1789-1799 qui, plus que toute autre, contribua à fabriquer l’Histoire de France, ses mythes et ses réalités, ses grandeurs et ses abîmes d’hier et d’aujourd’hui.
4) Paris médiéval
Professeur Reno Le mardi de 10h à 12h (il faut prévoir une demi-heure avant et après le cours pour les visites sur site)
À travers des textes écrits et des visites de monuments et de vestiges architecturaux du Moyen Âge, nous retracerons les grandes étapes de l’évolution historique et sociale de la ville de Paris depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au milieu du quinzième siècle. Parmi les textes, nous lisons le Siège de Paris par les Normands du moine Abbon, les Lettres d’Abélard et Héloïse, des extraits de la Vie de Saint Louis par Joinville et de la biographie du sage roi Charles V de Christine de Pizan, ainsi que le Procès de Jeanne d’Arc. Les visites sur site comprennent les Arènes de Lutèce, Saint Germain-des-Prés, la Conciergerie, Saint-Julien-le-Pauvre, la Sainte Chapelle, le Musée Carnavalet, le Musée du Moyen Âge, le Collège des Bernadins et le château de Vincennes.
.
___________________________________________________________
Seminars (4)
1) Installations: lieux et espaces dans l’Art contemporain
Professeur Kraguly Le mercredi de 11h à 13h (Il faut prévoir une demi-heure avant et après le cours pour les visites sur site)
Dépassant les catégories du modernisme, l’art depuis la deuxième partie du XXème siècle expose un nouveau type d’œuvres définies par le traitement de l’espace, du lieu et du matériau.
Héritière des ready-mades de Duchamp et de Merzbau de Schwitters, l’installation apparaît comme un jeu sur l’éphémère et l’espace environnant. L’installation est un site spécifique conçu par l’artiste. La scénographie et la construction spatiale de l’œuvre englobe le concept du Gesamtkunstwerk – »travail total d’art ». »Travail total d’art » comprend de différents formes et aspects d’art.
Objet de controverses, les installations deviennent un terrain de réflexion, où la relation du spectateur à l’oeuvre et les mécanismes du monde de l’art trouvent de nouvelles formes.
Ce cours abordera les nombreux aspects historiques et contemporains de l’espace du site et des matériaux. Le cours s’articulera autour des thèmes proposés : Espace analytique, Espace privé vs espace public, Espace encombré, Construction/Déconstruction de l’espace, Espace de l’échange et Espace immersif.
Objectifs du cours :
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir :
* La connaissance de certains mouvements artistiques et de certaines idées
* La compréhension de différentes approches et sujets caractéristique à l’art
* L’habilité d’identifier et d’évaluer l’importance des œuvres d’art spécifiques
* L’habilité d’examiner l’œuvre d’art dans le contexte de société dont il est issu
* La compréhension du vocabulaire spécifique à l’art
.
2) L’art et la nature en France au XIXe siècle, du Romantisme à l’Art nouveau
Professeur Peigné Le jeudi de 13h30 à 15h30 (Il faut prévoir une demi-heure avant et après le cours pour les visites sur site)
L’objectif de ce cours est de proposer une large synthèse des divers aspects du Romantisme en France. Nous adopterons pour cela une approche à la fois historique, littéraire et artistique du mouvement, afin de mettre en rapport les événements politiques (Révolutions de 1830 et de 1848), sociaux (triomphe de la bourgeoisie, Révolution industrielle) et culturels (évocation de la musique et de l’opéra romantique par exemple). La dernière partie du semestre sera consacrée à l’influence prédominante du Romantisme sur l’art et la littérature françaises de la fin du XIXe siècle : nous aborderons ainsi la poésie avec Baudelaire, la peinture symboliste avec Gustave Moreau et enfin la sculpture avec Rodin. Le cours alternera les séances dans les musées parisiens (Louvre, musée Delacroix, musée Carnavalet, musée d’Orsay et musée Rodin) et les séances en salle à Reid Hall, organisées autour de projections et de lectures d’auteurs célèbres (Hugo, Lamartine, Balzac) ou méconnus (Auguste Barbier, Aloysius Bertrand) afin de mettre en avant les liens entre arts plastiques et littérature.
3) Panorama du théâtre contemporain
Professeur Clément Le mercredi 17h à 19h
Le cours se propose d’offrir aux étudiants, à partir d’un programme précis, des ouvertures à la fois sur la scène parisienne et sur l’histoire et la tradition du théâtre occidental. Le cours est donc différent chaque année et même chaque semestre, puisqu’il dépend de la programmation des salles à chaque saison théâtrale. Il y a 12 séances de cours et six représentations dans des théâtres parisiens (elles sont obligatoires, les dates seront indiquées en début de semestre)
Le programme du cours “Panorama du théâtre contemporain” a été choisi parce qu’il permet un balayage assez vaste du théâtre depuis l’Antiquité grecque (un cours sur Platon et Aristote, un cours sur la naissance de la tragédie) au 20e siècle (le premier spectacle du semestre est d’après Beckett) en passant par Shakespeare, Molière et Marivaux; et parce qu’il devrait permettre, entre les différents spectacles, auxquels le cours préparera et qu’il commentera régulièrement, des incursions aussi bien dans les œuvres d’autres auteurs (par exemple Marivaux et Minyana sur la question des femmes) que chez des théoriciens importants du théâtre à l’époque actuelle (Brecht, Artaud, Boal, etc.)
La programmation du semestre sera l’occasion de faire le point sur le théâtre de l’absurde (à partir du premier spectacle du semestre), sur l’héritage de l’œuvre de Patrice Chéreau, metteur en scène français récemment disparu, et dont un spectacle fait partie de la programmation (un Shakespeare à l’Odéon).
.
4) Femmes, Féminisme, Genre en France (XIXe- XXIe siècles)
Professeur Taraud Le mardi de 14h30 à 16h30
Ce cours est une introduction générale à l’histoire des femmes, du féminisme et du genre dans la France contemporaine du XIXe au XXIe siècles. Dans ce cadre il s’agira de mettre en exergue plusieurs questions centrales de la problématique : 1) L’histoire des relations entre femmes, féminisme et genre en France de la Révolution française de 1789 à nos jours, en mettant particulièrement l’accent sur la première vague de féminisme (1880-1970) et sur la seconde (années 1970) ; 2) Comment les questions de femmes, de féminisme et de genre résonnent dans les débats très contemporains (parité, prostitution, pornographie, mariage gay, homoparentalité …) de la France d’aujourd’hui ; 3) Et enfin comment croiser les questions de genre et les questions post-coloniales pour mieux comprendre et analyser les polémiques “récentes” en France (voile islamique par exemple). Il s’agira donc ici de mieux saisir la manière dont l’héritage colonial (pratiques et représentations) « travaille » la France des années 2000-2014, surtout à partir de populations africaines et maghrébines (notamment algérienne) considérées, tout particulièrement depuis le milieu des années 1980, comme spécialement “problématiques” pour le modèle français et “l’identité nationale”.
.